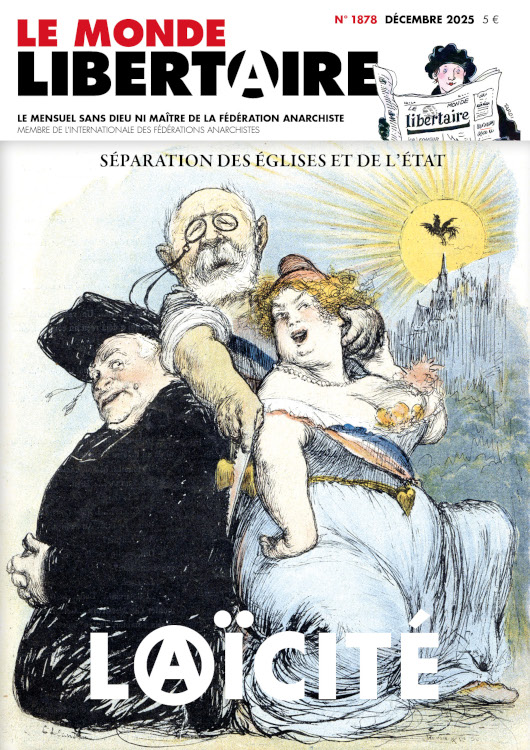Le polar, scalpel éthique de la critique sociale
mis en ligne le 18 décembre 2013
Quel sens donner à nos existences en Occident où les repères apparaissent souvent davantage brouillés et où les cadres religieux sont globalement en recul et/ou font l’objet d’appropriations plus individualisées, moins contrôlées par des institutions contraignantes ? La question philosophique du sens est certes ancienne, mais elle n’a peut-être pas toujours existé sous cette forme explicite, et en fonction des périodes historiques et des sociétés, elle a pu prendre des tonalités diversifiées.Le sens et la critique sociale
Nos sociétés occidentales contemporaines, et au-delà avec les logiques mondialisatrices, sont travaillées par des dérèglements divers qui pèsent sur cette question du sens, et notamment des inégalités entre classes liées aux structures du capitalisme, des dominations et des discriminations en interaction avec l’exploitation capitaliste du travail humain mais irréductibles à elle (sexistes, racistes, homophobes, etc.), une corruption des valeurs démocratiques du champ politique par les maléfices du pouvoir, le carriérisme et/ou l’argent, les dégâts sur les univers naturels et les relations sociales générés par le productivisme propre à la logique du profit, ainsi que des incertitudes liées au processus moderne d’individualisation et à ses approfondissements.
Le genre « polar », et en son sein tout particulièrement la tradition du « roman noir américain », peut éclairer de manière critique la façon dont se pose la question du sens à l’intérieur du réel social-historique. Dans cette perspective, la philosophie et la sociologie critiques peuvent nous aider à mieux comprendre ce que nous dit le polar dans son registre propre et, en retour, le polar peut nourrir les outils de la philosophie et de la sociologie critique. Le roman noir, instrument de critique sociale distinct de la sociologie, peut ainsi alimenter un questionnement spirituel, non nécessairement religieux, en l’ancrant dans les coordonnés sociales et historiques qui sont les nôtres. Et il le fait en mettant l’accent sur les zones noires et grises de nos vies. Ce seront les principales pistes explorées ici.
Le roman noir américain naît dans les années 1920. Deux des figures principales de ce que l’on appelle aussi la « hard-boiled school » (littéralement « école des durs à cuire ») sont Dashiell Hammett (1894-1961), inventeur du détective Sam Spade, et Raymond Chandler (1888-1959), créateur du détective Philip Marlowe. Certaines de leurs histoires ont d’ailleurs été adaptées au cinéma, qui a donné au roman noir une seconde vie populaire, mais dans un registre culturel différent, avec le film noir américain, dont l’acteur Humphrey Bogart a été une étoile marquante. Le roman noir revêt deux grandes caractéristiques : 1) un ancrage social, avec un regard critique sur la société moderne, et 2) une vision désenchantée qui tend toutefois à préserver souvent une composante morale. C’est du moins ce qu’en dit Jean-Patrick Manchette (1942-1995), lui-même auteur de romans policiers (comme Nada, Le Petit Bleu de la côte ouest, etc.) et initiateur, à partir du début, des années 1970 de ce qu’on a appelé « le néopolar » français, se revendiquant de la tradition américaine. Sur le premier plan, Manchette caractérise le polar par une voie « réaliste-critique » avec un parti pris « d’intervention sociale très violent » 1. Sur le second plan, il avance que « le polar est la grande littérature morale de notre époque » 2, mais dans le cadre d’« un chant tragique » 3. Par ailleurs, dans ce premier portrait global du noir, il ne faudrait pas oublier que c’est avant tout une affaire d’hommes, et qu’un de ses angles morts tendanciels, non perçu par Manchette, est empli de stéréotypes machistes et virilistes.
Roman noir : la noirceur de l’expérience tend à donner une tonalité particulière à cette forme littéraire. C’est comme s’il y avait, dans les brûlures générées par les épreuves de la vie, un fil analogique qui reliait des trajets biographiques, des conditions d’écriture et des conjonctures sociohistoriques disparates. Le scepticisme à l’égard de nos sociétés et de leurs conventions, comme des humains qui s’y « agitent », l’ironie sombre à l’égard de soi (dans le cas du héros-narrateur) et des autres, voire les attraits du cynisme ou d’un relativisme immodéré (du type « tout se vaut »), sont plus ou moins au rendez-vous. Une telle ambiance peut nourrir une radicalisation de la critique des institutions de nos sociétés. Cette critique sociale semble hésiter entre la réouverture de l’espace des possibles face à la fermeture dominante du réel et un fatalisme du « à quoi bon » parce que « tout est gangrené ».
De ce point de vue, le polar nous invite fréquemment à marcher sur une corde raide, en mêlant une double portée finement intriquée : de philosophie aux parfums métaphysiques – ce sont les âmes des personnages qui apparaissent affectées – et de sociologie critique – cela s’inscrit dans la mise en cause des désordres de la vie (et de la ville) moderne. De cet art funambulesque, j’ai extrait trois figures que le recours à cinq romans 4 me permettra de travailler :
1. La figure de l’extrême scepticisme (Robin Cook).
2. Celle du retour à un absolu (James Lee Burke).
3. Celle, plus floue et insolite, à laquelle j’ai donné ailleurs le nom compliqué de « transcendances relatives » (Harrison Hunt, Howard Fast, James Crumley), c’est-à-dire des repères juste au-dessus de nos têtes, comme une boussole « transcendante », afin de nous aider à nous orienter, mais fabriqués à partir des fragilités humaines, et donc « relatives » à ces fragiles humanités 5.
Ainsi les personnages principaux du Britannique Robin Cook (1931-1994) nous entraîneraient irrémédiablement vers le vide, ceux de James Lee Burke (né en 1936) s’en sortiraient en retrouvant la figure protectrice d’un dieu, tandis que ceux de Harrison Hunt 6, de Howard Fast (1914-2003) et de James Crumley (1939-2008) caleraient leurs routes sur des repères plus fragiles ; chacune de ces figures débouchant sur une éthique ajustée (une éthique du suicide chez Cook, une éthique religieuse chez Burke, un certain sens de l’orientation éthique en situation chez Hunt, Fast et Crumley).
Éthiques et mélancolie
Nos cinq romans expriment tous une exigence éthique : très pessimiste chez Robin Cook, aimantée par une voix divine chez James Lee Burke ou ballottée par la fragilité de repères simplement terrestres chez Harrison Hunt, Howard Fast et James Crumley. « Tous moraux, ces mecs », lance Manchette 7. Mais, à chaque fois, ni l’abandon, ni l’arrogance, ni l’éclatement (« s’éclater » dans l’éclatement des significations), si choyés par la culture « postmoderne », ne sont au rendez-vous, mais plutôt une certaine tenue, malgré tout, par-delà les déceptions et la douleur. Comme si, face à la déliquescence généralisée, et même si des compromis quotidiens avec le mensonge et l’injustice apparaissent nécessaires pour survivre, il fallait préserver un noyau d’intégrité personnelle. Pour ne pas être complètement emporté par le mal (Robin Cook), par la violence et l’autodestruction (James Lee Burke) ou rester disponible aux miracles humains de l’amour (Harrison Hunt, Howard Fast, James Crumley).
Les éthiques du polar ont intégré l’expérience du tragique, au sens que le philosophe Clément Rosset, dans le sillage de Nietzsche, a donné à ce terme. Le tragique, c’est par exemple se cogner à une mort accidentelle 8, dans ses dimensions « insurmontables » 9, « irrémédiables » et « imméritées ». Quand un événement, dans ses douleurs et parfois ses plaisirs, déborde les catégories morales traditionnelles. Comme Clément Rosset, James Lee Burke, Robin Cook, James Crumley, Howard Fast et Harrison Hunt récusent une éthique qui consentirait « à cet oubli du tragique » 10.
Ni le refus nietzschéen des notions de bien et de mal ni la joie nietzschéenne ne naissent pour autant de ce constat, plutôt la mélancolie, dans un rapport relatif mais effectif aux catégories traditionnelles de la morale. Reconnaître les faiblesses de la morale face à l’événement tragique ainsi que nos propres faiblesses morales, ce n’est pas nécessairement récuser la part morale de nos existences. Le philosophe Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) suggère dans cette voie : « Si nous devons retrouver une morale, il faut que cela soit au contact des conflits dont l’immoralisme a fait l’expérience 11. »
C’est pourquoi l’éthique du polar suit largement les chemins d’une mélancolie tragique, en restant toutefois, chez certains, disponible aux trouées de l’utopie amoureuse ou amicale, dans une mélancolie se faisant plus radicale, car ouverte sur l’avenir 12. Merleau-Ponty, encore lui, nous invite à mettre en tension les composantes tragiques et utopiques à l’œuvre dans une histoire humaine contingente marquée par une certaine imprévisibilité : « Le monde humain est un système ouvert ou inachevé et la même contingence fondamentale qui le menace de discordance le soustrait aussi à la fatalité du désordre et interdit d’en désespérer 13. »
Les romans de Harrison Hunt, Howard Fast et James Crumley s’engagent timidement et prudemment dans cette direction, en donnant toutefois au pôle tragique davantage de poids.
Cette première traversée fragmentaire des contrées du polar nous a permis de découvrir des matériaux inhabituels, peu souvent sollicités, pour relancer des questions existentielles, plus classiquement traitées avec les ressources de la philosophie. Une politique qui se préoccuperait de repères à reconstruire, hors des protections de l’absolu et des facilités du relativisme, aurait peut-être quelques enseignements à en tirer. Mais c’est une autre histoire, qui risque de peu intéresser les politiciens professionnels ou les avant-gardes révolutionnaires autoproclamées… 14
Philippe Corcuff
1. J.-P. Manchette, Chroniques, Paris, Rivages, 1996, p. 12 (juin 1980).
2. Ibid., p. 31 (janvier 1978).
3. Ibid., p. 36 (février 1978).
4. Il s’agit dans l’ordre de mon traitement de : Robin Cook, Il est mort les yeux ouverts (He Died With His Eyes Open, 1er éd. : 1983), trad. franç. de J.-B. Piat, Paris, Gallimard, collection « Folio », 1989 ; James Lee Burke, Prisonniers du ciel (Heaven’s Prisoners, première éd. : 1988), trad. franç. de F. Michalski, Paris, Rivages/noir, 1992 ; Harrison Hunt (pseudonyme de Willis Ballard et Norbert Davis), À l’estomac ! (Murder Picks The Jury, première éd. : 1947), trad. franç. de J. Papy, Paris, Gallimard, collection « Série noire » (n° 84), 1951 ; Howard Fast, Sylvia (première éd. : 1960), trad. franç. de L. du Veyrier, Paris, Rivages/noir, 1990 ; et James Crumley, Le Dernier Baiser (The Last Good Kiss, 1e éd. : 1978), trad. franç. de P. Garnier, Paris, Gallimard, collection « Folio policier », 2006.
5. C’est autour de la notion-problème de « transcendances relatives » que sont menées les « investigations existentielles » de mon livre La Société de verre. Pour une éthique de la fragilité, Paris, Armand Colin, 2002.
6. Norbert Davis (1909-1949) – celui qui, avec Willis Ballard (1903-1980), se cache sous le pseudonyme de Harrison Hunt – était l’un des auteurs de polar préférés du philosophe Ludwig Wittgenstein dans les années 1940 (voir Ray Monk, Wittgenstein. Le devoir de génie, première éd. : 1990, Paris, Odile Jacob, 1993, p. et 517-518). Il s’est suicidé en 1949.
7. J.-P. Manchette, Chroniques, op. cit., p. 32 (janvier 1978).
8. C. Rosset, La philosophie tragique (1er éd. : 1960), Paris, PUF, collection « Quadrige », 1991, p. 8-9 et 27-29.
9. Ibid., p. 38.
10. Ibid., p. 31.
11. M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens (1er éd. : 1948), Paris, Gallimard, 1996, p. 8.
12. Sur la mélancolie radicale dite « classique » (Saint-Just, Blanqui, Benjamin…), voir D. Bensaïd, Le Pari mélancolique, Paris, Fayard, 1997, p. 233-258.
13.M. Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste (première éd. : 1947), Paris, Gallimard, collection « Idées », 1980, p. 309.
14. Extraits de l’introduction et du chapitre 1 de Polars, philosophie et critique sociale (Paris, éditions Textuel, collection « Petite Encyclopédie critique », octobre 2013).