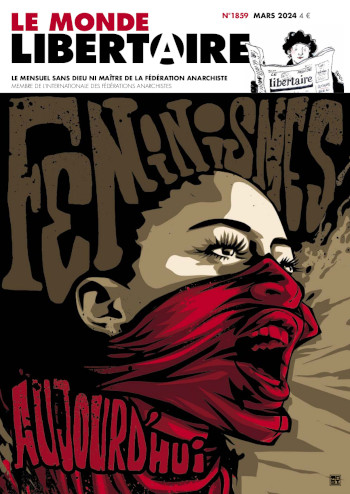Le Portugal sous le joug du capital : état des lieux de l’exploitation et des luttes
mis en ligne le 10 février 2011
Comme celle de la Grèce et de l’Irlande, la situation financière du Portugal est devenue un problème. Les raisons ne sont pas forcément les mêmes. Au Portugal, il y a un problème structurel issu du régime fasciste et du modèle de société choisi par Salazar : forte ruralité, secteur industriel faiblement développé et concentré dans les secteurs traditionnels, faible scolarisation, absence de voies de communication rapides, etc. Les années qui suivent la chute du fascisme en 1974 ont vu naître rapidement un pays plus moderne, plus en accord avec les standards de vie et de consommation européens, mais avec tous les problèmes d’un développement inégal et soumis à la logique du capitalisme libéral. Maintenant, avec une économie complètement ouverte à l’extérieur, le Portugal dépend de ses exportations et surtout, pour maintenir un PIB et une croissance modestes, de la bonne performance de l’économie européenne, espagnole en particulier. Le problème est que ni la première ni la seconde n’est en mesure d’être le moteur d’aucun développement.
2010 a été choisie comme l’année du combat contre la pauvreté. Le gouvernement « socialiste » du Portugal a probablement mal compris l’objectif et sa lutte contre la pauvreté est devenue une lutte… contre les pauvres. Depuis 2009, des mesures de restriction – poétiquement appelées « Planos de Estabilização e Crescimento » (plans de stabilisation et croissance) – se succèdent. Ces mesures se sont traduites surtout par une augmentation du chômage, des prix des produits de base, des impôts et une réduction des aides sociales, des retraites, des pensions, des salaires. Au-delà d’un taux de chômage qui approche des 11 %, la précarité du travail est absolue chez les jeunes. Le nombre de sans-abri peuplant les rues des villes portugaises a augmenté au cours de ces deux dernières années. La pauvreté touche des centaines de familles dites « de la classe moyenne » qui sont obligées de recourir à l’Assistance sociale publique ou aux ONG.
La grève générale du 24 novembre est surtout un exemple de l’incapacité des syndicats de s’imposer comme alternative et du rôle qu’ils jouent dans la gestion du système capitaliste. Celui-ci a évolué d’une façon bien différente que celle prévue par Marx. À mon avis, le capitalisme ne finira pas dans une grande crise finale à cause de ses contradictions internes. Bien au contraire, il a profité de toutes ses prétendues « crises » pour intensifier l’exploitation des classes populaires. Et ça, parce que, a contrario de ce que disait Marx, et de ce que dit aujourd’hui la classe dominante, il n’y a pas de crises du capitalisme. C’est le capitalisme qui est vraiment la crise. Les syndicats, quant à eux dans les mains des syndicalistes de carrière, sont devenus des acteurs fondamentaux dans la construction d’une société chaque jour plus oppressante, et cela depuis qu’ils se sont complètement intégrés dans l’appareil d’État et dans le système techno-industriel. Dès lors, face aux mesures de restrictions très dures annoncées par le gouvernement portugais, c’était sans aucune surprise que l’on a entendu le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs portugais-Intersyndical (CGTP-IN) – organisation encore profondément contrôlée par le Parti communiste –, M. Carvalho da Silva, dire en interview à la radio, qu’« après ces nouvelles mesures du gouvernement, il faut donner quelque chose aux Portugais. Il faut faire un jour de grève générale sinon ils peuvent sortir dans la rue et, comme nous le savons, la rue ne négocie pas ». Les dirigeants syndicalistes portugais ne veulent pas de confusion dans la rue. Ils aiment s’asseoir avec les patrons et le gouvernement sur les chaises de la concertation sociale. Ils aiment partager le pouvoir.
Le jour de la grève générale a été important, avec une forte adhésion du secteur public : éducation, santé, transports. Dans l’après-midi, une manif a parcouru la plus importante avenue de Lisbonne, avec un cordon de sécurité tenu par les gorilles de la CGTP-IN qui empêchaient « les anars et d’autres éléments radicaux et violents » d’y participer. Après cette marche officielle, les anarchistes ont réussi à faire une manif alternative et très joyeuse, avec environ 500 personnes défilant aux cris de « Grève générale jusqu’au Carnaval ». Le soir, la CGTP-IN a annoncé une grande victoire de la classe ouvrière. Le lendemain tout le monde est retourné au boulot et a renoué avec l’exploitation…
Le cirque a continué le dimanche 23 janvier avec des élections présidentielles. Contrairement à la France, le Portugal n’est pas un régime politique présidentiel. Le président de la République a donc des pouvoirs très limités, mais il y en a un que la droite voudrait utiliser : celui de changer ce gouvernement, de dissoudre l’Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections législatives. Pour certains tenants de la droite, les mesures déjà annoncées par ce gouvernement ne sont pas suffisantes. D’une façon claire, la droite veut en finir avec le peu qu’il reste de l’État social : le service national de santé à tendance gratuite, la Sécurité sociale publique, les aides aux couches les plus défavorisées de la population. Le résultat de ces élections était prévisible : un second mandat pour l’actuel président, Cavaco Silva, un ancien Premier ministre de centre droit dans les années quatre-vingt. Les attentes de la droite sont grandes. Mais, jusque-là, le gouvernement du Parti socialiste se met au service du capital et du patronat. La dernière proposition de loi vient directement de la ministre du Travail : réduction des indemnisations versées aux travailleurs en cas de licenciement. Aujourd’hui, un mois de salaire par année travaillée. Demain, quinze jours seulement.
Les anarchistes le savent : les possibilités traditionnelles d’expression politique dans les sociétés dites démocratiques – le vote, les partis, les syndicats – sont chaque fois moins crédibles du fait de leur incapacité à trouver des solutions, mais aussi en raison de leur complaisance à l’égard des formes d’exploitation capitaliste (corruption et népotisme). L’État, et le système politique qui le soutient, est le grand supporter du capitalisme et la frontière qui les sépare est ténue. Ce scénario est déjà vécu, notamment dans les pays du Sud de l’Europe, par les dépossédés de la société : jeunes, chômeurs, sans-abri, minorités sexuelles ; mouvements et associations d’individus qui luttent contre les projets techno-industriels ; individus et groupes qui prônent et pratiquent une forme de vie plus simple en dénonçant la consommation et le productivisme ; travailleurs contrariés qui ont compris que leur émancipation ne réside pas dans l’emploi ou l’augmentation du salaire, mais dans la fin d’une société qui impose la servitude salariée et la production d’objets inutiles ; mouvements de femmes qui ont compris que le vrai féminisme n’est pas dans le droit de vote ou dans le salariat.
Les luttes qui se déroulent dans les rues de Grèce, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre ou de France sont un signe. D’autant plus que des groupes ont déjà commencé à pratiquer des formes de lutte libertaires qui échappent au contrôle des partis, des syndicats, de l’ordre établi et qui entraînent avec eux des secteurs moins engagés de la population. Un jour, je l’espère, on verra ça dans les rues portugaises…
Mário Rui
Article transmis par les Relations internationales de la Fédération anarchiste