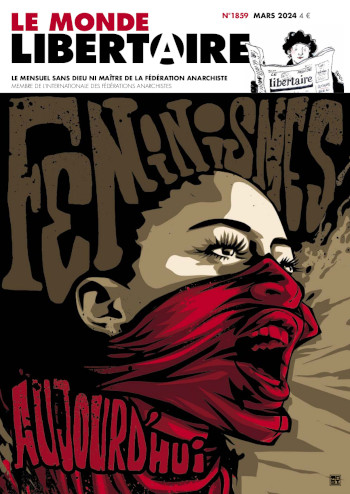Sic transit gloria Dubaï
mis en ligne le 10 décembre 2009
Adieu veaux, vaches, cochons, même si dans le très musulman émirat de Dubaï, on ne rencontre que peu de cochons, du moins de ceux à quatre pattes.Nakheel, une compagnie qui appartient à Dubaï World, qui appartient au gouvernement de Dubaï, qui appartient à la dynastie des Maktoum, ne remboursera pas ses dettes pendant six mois. 59 milliards de dollars de dettes. Les dettes totales du gouvernement de Dubaï se montent à 80 milliards de dollars.
Nakheel a construit les îles en forme de palmiers sur l’océan, et quelques autres joyeusetés du même genre. Pour deux raisons : faire parler de Dubaï et donc attirer les investisseurs ; vendre les îles et donc gagner de l’argent. Si Nakheel a bien vendu les maisons sur le Palm Jumeirah, elle n’a vendu aucune des îles artificielles du projet mégalomane « The World » lequel dessinait la carte du monde, excusez du peu, en îles artificielles sur les eaux du Golfe Persique. Une île artificielle, ça coûte très cher. Il faut être très riche. Mais si l’on est très riche, pourquoi aller dans un pays où il fait 50 degrés pendant quatre ou cinq mois, où il y a beaucoup moins de femmes que d’hommes, où il n’y a rien d’autre à voir que quarante shopping malls, tous équipés des même franchises banales que partout ailleurs, de Starbucks à Zara en passant par The Body Shop ?
Dubaï a peu de pétrole. Aussi les Maktoum ont-ils compté sur la protection des États-Unis ; le statut de zone pacifique dans une région de guerres ; la proximité des capitaux arabes ; l’arrivée de capitaux à blanchir, principalement ex-soviétiques ; leur position géographique idéale entre l’ancien pouvoir économique l’Europe, et le futur pouvoir économique, l’Asie ; l’arrivée en masse de professionnels déjà formés, à chaque crise d’un des pays de la région, en particulier l’Iran, l’Inde et le Pakistan ; leur amitié envers tout le monde, le nationalisme arabe comme le capitalisme américain, l’impérialisme russe comme la sauvagerie Al-Qaedesque ou Bushite, les mafias d’Asie centrale comme les pilleurs de l’Afrique, etc.
Ils utilisèrent les revenus du pétrole pour désensabler la crique, construire un aéroport, creuser un gigantesque port, préparer les quartiers d’habitation pour les milliers de cadres, de techniciens et de sbires expatriés dont Dubaï aurait besoin. Ils planifièrent le développement futur de la ville dès les années soixante, pariant qu’un trou perdu deviendrait une métropole.
Il leur fallait une ville disposant d’une masse critique de population et d’activités suffisante pour que, quelle que soit la situation économique, elle attire sans cesse, parce que les possibilités économiques y sont suffisamment vastes et diversifiées. Et ils voulurent ajouter tant au port franc qu’à la plaque tournante des capitaux une « gated community » des riches de la planète. Cependant les riches ne manquent pas de « gated communities » où le thermomètre ne monte pas à 50 degrés l’été. De là, cette surenchère architecturale qui a rendu, comme c’était son but, Dubaï célèbre : l’hôtel sept étoiles en forme de voile, la tour la plus haute du monde à 818 mètres, l’île artificielle en forme de palmier.
Il y a trois Dubaï. Le réel, le rêvé, le menaçant. Le Dubaï réel est unique dans l’histoire ; le seul État dont la croissance fulgurante ait été obtenue sans la moindre violence, jusqu’à la création de l’actuel hybride mi-Los Angeles, mi-Lausanne ; une ville trop étendue, trop dépendante de l’automobile, une ville lacérée par d’immenses autoroutes impassables ; une ville, peut-être la plus cosmopolite qui fut jamais, mais stérilisée par ses shopping malls ; une ville où les architectes, malgré des possibilités uniques, n’ont empilé que clinquant et chromé ; une ville-façade, où, comme l’avait prédit Debord, « le vrai n’est qu’un moment du faux », où le faux abonde, déborde, où tant est imité, si peu est créé ; une ville où les conflits de peuples et de classes sont prévenus par une ségrégation précise à l’extrême qui n’autorise à cohabiter que des identiques ; une ville étonnamment sûre… parce que les habitants y sont filtrés, limités à la catégorie des travailleurs entre 20 et 50 ans, de préférence mâles, et où le moindre conflit social, le moindre risque humain n’ont pour seul remède, comme la saignée et la purge qui soignaient tout jadis, qu’un siège dans un avion sans retour ; une ville qui, pour faire régler ses dettes par l’État-frère Abu-Dhabi va peut-être devoir choisir entre d’une part ses liens privilégiés avec l’Iran, à qui elle sert de communication avec l’extérieur, et d’autre part ses liens privilégiés avec l’axe Abu-Dhabi/États-Unis qui déteste ce double jeu ; une ville bigoto-pécheresse où la tolérance se résume à la prostitution et à l’alcool ; une ville dont on ne sait si elle mine l’islam en y injectant les insidieux poisons de la modernité, ou si au contraire elle le conforte en lui procurant une soupape de sûreté géante.
Le Dubaï rêvé est celui qu’avait patiemment serti l’émir actuel. Serti dans les médias du monde entier, dans le spectacle, au sens situationniste. Il suffit de se remémorer l’apologue du professeur Nozick. Dans Anarchy, State, Utopia, Nozick imagine une boîte où barboterait un cerveau humain, qui permettrait à ce cerveau de croire vivre ses désirs, aussi impossibles soient-ils. Célébrité, richesse, génie, amour, sans fin, sans limite, de quelque manière que l’on veuille. Sans pourtant jamais n’être autre chose qu’un cerveau dans une boîte.
Nozick se demande si, à supposer que l’on fabrique un jour cette boîte, certains la vendraient et certains l’achèteraient.
Cela ressemble-t-il à Dubaï ? Oui, car le Dubaï moderne a été édifié non tant sur le sable, que sur une pyramide de mythes.
En bas, au fond, le mythe le plus vaste. Celui du paradis régressif de la gratification immédiate, de la consommation déchaînée. Le lieu où l’on pêche à foison des esclaves, mâles pour travailler, femelles pour forniquer, où l’on jouit de climats mélangés (le ski dans le désert), où l’on construit les tours de Babel. Dubaï, le lieu où les adultes reviennent à l’omnipotence enfantine, pour gratifier leurs désirs d’adultes. Dubaï, le bordel bien élevé de la planète.
Juste au-dessus de ce mythe de fond, les deux mythes du capitalisme :
En mode mineur, la domination continue de l’humain sur la nature.
En mode majeur, la domination continue des riches sur les pauvres, des résolus sur les résignés.
En haut de la pyramide, bien visible, la perception mille fois répétée : « il n’y avait rien à Dubaï, donc tout y est possible ». Tout : bâtir une voile de bateau qui soit un hôtel ; construire une île (non, trois îles) sur du sable, c’est-à-dire mettre la terre sur la mer ; semer de la neige dans le désert, etc. Ce mythe-là susurre aux riches que Dubaï est le lieu magique de la coincidentia oppositorum, de la conciliation des contraires. Le lieu où la croissance économique jaillit sans terroristes, sans adolescents, sans grèves, sans politique, sans impôts. On sature donc la ville d’éjaculats de croissance : l’hôtel le plus cher du monde, la tour la plus haute du monde, les plus grands shopping malls du monde.
On dirait un quartier chaud, on dirait les néons d’un quartier chaud : ça brille, il y en a beaucoup, toujours plus, aucune promesse n’est interdite. La prostitution se résume à l’art de convaincre le miché qu’un peu d’argent lui donnera beaucoup de bonheur. Le capitalisme se résume à l’art de convaincre le travailleur qu’un peu de travail lui vaudra beaucoup d’argent. Le Dubaï rêvé se résume à l’art de convaincre les riches que l’argent permet de vivre comme les dieux.
Le Dubaï menaçant dépasse le Dubaï rêvé, mais procède de lui. Ou plutôt de l’écart entre le rêvé et le réel. Car pour que les mythes du Dubaï rêvé ne soient pas trop mis à mal par la réalité, il fallait que le pays ne soit pas un pays.
Un vrai pays regorge de vieux, d’adolescents, de malades, de mendiants, ces inutiles qui empêchent de croire qu’on peut vivre comme des dieux. Il faut que le pays ne soit qu’une entreprise, que la société ne soit une société qu’au sens commercial.
De là, comme dans une entreprise explicite, l’usage des travailleurs jetables. Ils ne viennent que pour travailler, sans leurs familles. Comme dans une entreprise avouée, il n’y a pas de polis, pas de communauté, pas d’institutions indépendantes, seul le réseau entrecroisé des chefs décide. Les patrons dubaïotes ne se distinguent guère de leur gouvernement, auquel à l’inverse nul n’appartient sans posséder d’importants intérêts commerciaux ou industriels. À Dubaï, le pouvoir commence avec la famille Maktoum. Puis s’étend, vers le haut, en direction d’Abu-Dhabi, le partenaire plus cossu, et vers les côtés en direction des grandes familles marchandes locales.
Aux riches étrangers, les Guizot des sables répètent sans cesse, enrichissez-vous. Aux travailleurs étrangers, les Guizot des sables ne répètent rien, et ne les paient régulièrement que s’ils sont indispensables. Aux touristes étrangers, aux bourgeoisies arabes, africaines, indiennes, iraniennes en goguette, les Guizot des sables tendent la serviette et le savon, comme les sous-maîtresses des bordels de l’autre siècle les tendaient aux conscrits en bordée.
La mort, l’extermination de la politique. L’État limité à ses deux rôles minimaux, créateur de la monnaie et maton de la plèbe. Dubaï SA plie le genou devant l’économie reine, l’économie ayant enfin tout conquis, le pouvoir, l’espace, le temps, la perception, la réalité, l’imaginaire. Le règne nu de la marchandise enfin débarrassé des fictions politiques, des oripeaux constitutionnels, du cache-misère appelé démocratie.
Dubaï ressemble beaucoup, sinon à notre avenir, du moins à l’avenir que la marchandise se souhaite.