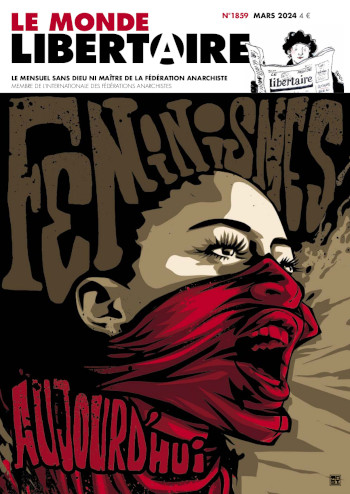Martinique, années soixante : entre misère et révolte
mis en ligne le 16 février 2012

Après la Seconde Guerre mondiale, la Martinique fait partie de ces « îles à sucre » qui, en échange, reçoivent de la métropole l’essentiel de leurs produits de subsistance, car aucune industrie autre que la transformation des produits de la canne n’y existe. La départementalisation obtenue au début des années 1950 prive l’ancienne colonie de ces échanges réglementés et ne modifie pas fondamentalement la relation de dépendance avec la métropole. La quasi-monoculture de la canne reste contrôlée par un petit groupe de possédants, presque tous des Blancs créoles, dont les plus riches entretiennent des réseaux d’influence dans et hors de l’île. Au début des années 1960, la situation économique et sociale est déplorable pour les masses pauvres de Martinique. Le spectre de l’effondrement du marché sucrier, mis en scène par la fermeture d’usines et de nombreuses distilleries, permet de tempérer les revendications des milliers de travailleurs. Le salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG), né avec la loi du 11 février 1950 et indexé sur le coût de la vie en France, n’est même pas appliqué aux Antilles, alors que les conditions de vie et la situation réelle des travailleurs y sont pourtant connues et rapportées par les services des Renseignements généraux : sous-emploi chronique, salaires inférieurs de 17 % alors que le coût de la vie est supérieur de 65 % à celui de Paris (en 1958), réduction des prestations sociales indexées… Et cette inégalité flagrante perdurera longtemps ! Le gouvernement post-colonial de l’époque, cherchant à éviter l’explosion sociale, met en place le Bumidom (Bureau d’émigration de la jeunesse vers la France). Mais le sentiment d’injustice, face à une décolonisation de façade qui n’a rien modifié des rapports sociaux préexistants, se mue peu à peu en désir d’indépendance. En 1963 l’affaire dite de l’Ojam (Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise) avait révélé la répression du pouvoir sur des groupes nationalistes soupçonnés d’action subversive. Mais elle avait aussi révélé l’existence d’une certaine contestation et d’une révolte sourde au sein de la jeunesse. Une fraction de cette jeunesse est alors sensible aux idées anticolonialistes alors que la guerre d’Algérie vient de se terminer et que les effets de la révolution cubaine, comme la révolte des Noirs américains, marquent les esprits. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre « l’affaire Marny » en septembre 1965. Son mitraillage par la police alors qu’il se rend les mains en l’air et sans arme, et la figure qu’il est devenu en quelques jours de cavale déclenchent des émeutes à Fort-de-France. Elles ne s’achèvent qu’avec la venue en renfort d’un escadron en provenance de Guadeloupe. Inquiet d’une éventuelle contagion de la révolte, de Gaulle envoie deux émissaires pour comprendre la situation. « Cette affaire est-elle politique, est-ce un mouvement anti-Français ? », demandent-ils à Me Valère, l’un de ses avocats.
Bien des années plus tard, en 2009, les laissés-pour-compte de Martinique feront à nouveau entendre la voix de la révolte…